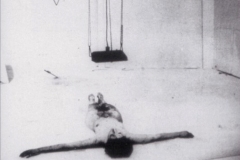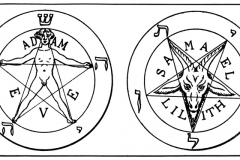Depuis des millénaires, le Diable ne cesse d’inspirer l’art, aussi bien sacré que profane. Figure du Mal absolu, vécu comme réel ou perçu tel un symbole, il se présente souvent comme un mal nécessaire à un accomplissement.
Le Diable : à l’origine, une créature permettant d’expliquer le Mal
Le Mal existe-t-il et pourquoi ? Quelle est son origine ? Est-il inscrit en l’homme ou extérieur à lui ?… Depuis toujours, hommes d’église, artistes et philosophes tentent d’apporter des réponses à ces questions. Pour l’expliquer, la tradition judéo-chrétienne se réfère à une créature, sans cesse changeante dans sa forme, empruntant mille noms différents. On la connaît sous le nom de Satan, de Lucifer, de Belzébuth ou plus simplement du Diable ou du Malin…
C’est sous le nom de Satan, l’Adversaire, que la créature apparaît la première fois dans l’Ancien Testament et se voit citée dans le Nouveau le plus souvent. Sous sa forme de serpent, elle tente Eve dans le jardin d’Eden. Ce qui dans la Genèse conduit l’Homme à son expulsion du Paradis et lui fait connaître depuis le Bien comme le Mal ici-bas. L’Eglise catholique considère que Dieu, le Créateur de toutes choses ne peut avoir créé le Mal. Ses Pères, dès le 3ème siècle, attribuent à Lucifer son origine, l’assimilant à Satan. L’histoire raconte que ce porteur de Lumière se révolte avec ses anges rebelles contre Dieu et se voit banni du ciel par l’archange Saint-Michel. Une scène fréquemment représentée dans l’art sacré du 9ème au 16ème siècle. Mais le Mal ne s’envisage pas toujours comme l’œuvre d’un ange chuté. Certaines traditions l’associent à une autre créature qui cherche à maintenir les hommes emprisonnés dans le Monde qu’elle a elle-même créé. Le manichéisme ou le gnosticisme chrétien nomment ce grand architecte maléfique le Démiurge ; le zoroastrisme évoque ce seigneur des ténèbres et du chaos sous le nom d’Ahriman. Quel que soit son nom, la créature se dispute néanmoins toujours au vrai Dieu l’adoration des peuples.
Le portrait du Diable : un mal nécessaire pour l’Eglise au Moyen Âge
Durant l’époque paléochrétienne, on ne trouve pas trace de représentation du Diable. Il n’apparait de même que rarement dans l’iconographie chrétienne des premiers siècles, les évangiles se référant à Satan comme à une figure du Mal non définie. Seule l’Apocalypse de Jean l’identifie à une bête (un dragon à 7 têtes) et à un chiffre (666). Le portrait du Diable se dessine véritablement au Moyen Âge. Une abondante littérature, dont tout particulièrement des récits de visions de Saints, le dépeint (ex : La légende dorée de Voragine). A cette époque, les images sont la Bible du peuple, en grande majorité illettré. Pour l’enseigner, le Clergé médiéval développe une esthétique codifiée de la figure du Mal. Le portrait du Diable doit marquer les esprits et éveiller les consciences des simples. Il lui faut rendre visible sa nature hybride inhumaine comme son but. Le Diable rend l’homme bestial ; il lui ôte son âme, l’empêchant ainsi d’accéder au Paradis après sa mort. Pour y parvenir, le Prince des tentateurs ne cesse de semer le doute dans son esprit tout au long de sa vie. A partir du 12ème siècle, afin de traduire en image les volontés de l’Eglise, les artistes s’inspirent de marginalia médiévaux, de monstres de l’Antiquité classique et d’êtres fantastiques orientaux et extrême-orientaux. Le satyre antique s’impose comme la référence majeure pour définir les canons de son portrait. Dans l’iconographie chrétienne, le Diable se présente également souvent sous une forme animale (le serpent, le dragon, l’âne, le singe, le bouc, le chat…). Il n’existe, par contre, pas vraiment de différence de représentation entre Lucifer, Satan ou Belzébuth. A partir du 14ème siècle, le Diable et son armée de démons prennent la forme de créatures hybrides monstrueuses de plus en plus élaborées (Bosch, van der Weyden, Memling, Grünewald…). Les artistes théâtralisent son intervention dans de savantes mises en scène (van Eyck, de Limbourg, Lochner, Fra Angelico). Mais, à la fin du 15ème siècle, cette surenchère d’exubérance et de complexité visuelle contribue à le décrédibiliser. La créature ne fait plus aussi peur ; son portrait tend vers le grotesque.
L’enfer des damnés : un au-delà terrifiant pour éveiller les consciences
Dans l’Art sacré, le Diable apparaît le plus souvent dans des scènes de tentation et au moment de la mort, lorsqu’il vient chercher le défunt. Son royaume souterrain y occupe lui aussi une place de choix. L’enfer hante les hommes du Moyen Âge pour qui la vie, simple étape, prépare au salut de l’âme. Cet au-delà se vit alors comme une réalité terrifiante. Afin de faire comprendre au fidèle ce qui l’attend, les artistes développent un puissant imaginaire dépeignant toute son horreur. La représentation traditionnelle de l’enfer s’inspire principalement d’un texte apocryphe de l’apôtre Paul et, bien avant La Divine Comédie de Dante qui en décrit une géographie en 9 cercles marquant toute l’histoire de l’art, de légendes irlandaises comme La vision de Tungdal ou Le voyage d’Owen. L’Eglise catholique l’envisage comme un monde de feu chaotique où règne la luxure et la souffrance. Les hommes damnés ne cessent d’y subir des supplices et s’y voient privés de la vision réconfortante de Dieu. Dès l’époque romane, les chapiteaux et les portails d’églises puis, à partir du 14ème siècle, les enluminures et la peinture mettent en scène cet enfer de même que la porte qui y mène : la gueule du Léviathan.
L’intériorisation du Diable : le choix de l’humanisme pour justifier le Mal
A la Renaissance, le regard que portent les hommes sur le Diable se transforme. Le Mal s’intériorise ; il devient une dimension de l’humain. Daniel Arasse dans Le portrait du Diable note que « l’humanisme porte un coup catastrophique à l’image traditionnelle du Diable car il donne une dimension philosophique et artistique à cette intériorisation du démon, au point d’exclure du champ de la représentation sa figure monstrueuse et objective ». A cette époque, la finalité de l’image change radicalement. Les artistes ne cherchent plus à suggérer symboliquement une vision sacrée de la vie liée à l’au-delà ; ils veulent imiter le réel d’ici-bas. La place de l’homme devient centrale. C’est pourquoi, dans l’art sacré, les grands maîtres privilégient dès lors les scènes de corps en prise avec un monstre intérieur à celles de créatures démoniaques se jouant des hommes (Botticelli, Michel-Ange, Signorelli…).
Même si, au départ, on représente encore la créature diabolique sous les traits d’un serpent ou d’un dragon, elle s’humanise et se voit peu à peu reléguée au rang de superstition. Au 18ème siècle, des écrivains comme Voltaire ou Béranger ne cessent de l’attaquer. Les scènes des enfers cèdent également la place à un thème qui reste très en vogue jusqu’au 19ème siècle : l’Ars moriendi (l’art de bien mourir). Le portait du Diable se retrouve ainsi progressivement remplacé par la figure humaine sous sa forme de portrait diabolique. Le Mal qui habite l’homme se dévoile tout particulièrement dans les traits monstrueux du visage ; ce que l’anthropométrie judiciaire à la fin du 19ème siècle tente à son tour de démontrer à partir de photos de criminels (L’Atlas de l’homme criminel de Lombroso). Au 20ème siècle, de célèbres plasticiens explorent de nouveau cet axe pour interroger les codes du portrait dans l’art (Sherman, Orlan…).
Le Diable incarné : un sujet idéal pour dénoncer le Mal et l’immoralité
Si, dans l’Art sacré, le Diable se fait dès la Renaissance plus discret, l’Eglise ne cesse néanmoins de l’instrumentaliser. Avec le développement de l’imprimerie, la diffusion d’images se généralise. La créature devient un personnage de propagande idéal dans la gravure. Plus que tout autre, elle permet d’illustrer la condition humaine : ses vices comme ses peurs. L’Eglise catholique l’utilise au départ pour « purger le Mal de la société ». En développant tout un imaginaire satanique autour de son culte – le sabbat-, elle mène, jusqu’au 18ème siècle, sa chasse aux sorcières comme à tous ceux ayant, selon elle, pactisé avec lui. A la Réforme protestante, Luther, quant à lui, n’hésite pas à assimiler le Diable à la papauté pour dénoncer les dérives de l’Eglise catholique. Il est le premier à vulgariser son image sous une forme satirique. La gravure et la presse populaire (les canards) démocratisent l’idée. La Contre-Réforme fait de même un peu plus tard, présentant Luther comme « le Diable incarné ». La créature maléfique demeure par la suite un sujet de prédilection pour dénoncer sur un ton satirique les guerres, la politique ou bien encore au 19ème siècle avec les diableries (des scénettes de sa vie en ‘’3D’’) critiquer les dérives de la société et l’immoralité.
La beauté du Diable luciférien : une source d’inspiration pour les artistes
Il faut attendre le romantisme noir du 19ème siècle pour que la créature maléfique opère son grand retour. Cette fois, le Diable ne fait plus peur, il fascine. L’artiste, scrutant ses profondeurs, non seulement s’y confronte dans ses songes mais pactise également avec lui. C’est par la littérature que le Diable regagne du terrain : grâce à Milton (traduit par Chateaubriand) qui dépeint un portrait héroïque et flatteur de Lucifer dans Le paradis perdu et à Goethe qui réinterprète l’histoire du Dr Faust et de Méphistophélès, un démon maléfique mais intellectuellement très stimulant. Faust inspire les œuvres d’illustres musiciens tels Berlioz, Gounod, Schumann, Wagner ou Liszt. Le pacte avec le Diable demeure par la suite un thème récurrent dans l’art. Lucifer, le rebelle épris de liberté capable de bouleverser l’ordre établi, s’impose pour sa part comme un modèle à suivre chez les artistes. Il devient le compagnon des poètes maudits et des peintres romantiques qui l’envisagent alors tel un feu intérieur aidant au dépassement, une source d’inspiration stimulante (Füssli, Blake, von Stuck…). A la fin du 19ème siècle, certains artistes se tournent de même vers le genre fantastique. Mais le surnaturel qu’ils décrivent n’a souvent rien de sacré. Il se perçoit davantage comme un naturel psychologique mystérieux restant à explorer. Le Diable s’y envisage comme un mal nécessaire qui, en dévoilant nos peurs les plus profondes et éveillant nos désirs refoulés, révèle notre part d’ombre (Hugo, Poe, Wilde…).
La glorification de Satan dans les Beaux-Arts : un moyen d’exprimer librement ses instincts
Au 19ème siècle, Lucifer ne sème pas seul le trouble chez les artistes. Satan fascine lui aussi des écrivains rejetant le matérialisme bourgeois (Baudelaire, Huysmans…). Certains s’aventurent à vénérer son style de vie. Dans une société qui se désacralise, ne cherchant plus le salut ni ne craignant la damnation, autant jouir des plaisirs du corps ici et maintenant. Le Marquis de Sade brise les codes de la morale, présupposant que l’homme peut sans limite exprimer toutes ses envies. Ses écrits transgressifs (Justine, Les 120 journées de Sodome…) glorifient tout ce qui jusqu’alors avilit l’homme : la luxure, la laideur, la violence, la souffrance et la folie qui conduit à la mort. Il transforme radicalement le regard que les artistes portent sur le corps et la sexualité, ce que des œuvres de Le Poitevin (les Diableries érotiques) ou de Félicien Rops commencent à illustrer à la fin de ce siècle. Le phénomène se généralise par la suite dans l’art même si, au début du 20ème siècle, seuls les surréalistes revendiquent ouvertement l’influence de Sade (Magritte, Masson, Fini, Dali, Bellmer…). De grands photographes contemporains comme Araki, Mapplethorpe, Witkins ou Serrano esthétisent les pratiques sexuelles déviantes. A partir des années 80, de célèbres plasticiens par une approche kitch accessible à tous contribuent de même à banaliser la pornographie (Jeff Koons, Gilbert and George, La Chapelle…).
Les guerres amènent néanmoins les hommes à un amer constat ; ce que la philosophe Anah Arendt décrit comme « la banalité du Mal ». A partir des années 70, des artistes contemporains se réapproprient le thème pour interroger la condition humaine, par nature diabolique. A cet effet, certains s’inspirent de l’iconographie religieuse, mettant en scène sa monstruosité au travers de corps martyrisés (Abramovic, Saville, Serrano, Quinn, les frères Chapman…). D’autres explorent la dualité intérieure, la part d’ombre énoncée par Jung (ex : Him de Cattelan représentant Hitler, figure du mal absolu tel un enfant angélique en prière ; l’homme double de Christine Borland, une série de 6 portraits différents du médecin nazi Josef Mengele…).
Le Diable au cinéma : un adversaire qui pousse à se dépasser
Si comme l’écrit en 1957 Bataille dans son essai sur l’œuvre de grands écrivains, le mal et la littérature sont fondamentalement inséparables, c’est le 7ème art, plus que tout autre, qui ne cesse à partir des années 70 de réactualiser les grands thèmes associés au Diable. Rosemary’s baby en 1968 ou La 9ème porte de Polanski en 1999 nous plongent dans l’univers du satanisme ; L’exorciste de Friedkin en 1973 ou La sorcière d’Eggers en 2016 évoquent la possession ; Faust de Murneau en 1926 , de Sokourov en 2011 ou encore La beauté du Diable de Clair en 1950 et Angel Heart de Parker en 1987 dépeignent un pacte avec le diable ; Constantine de Lawrence en 2005 ou Ghost Rider de Johnson en 2007 dressent le portrait d’un purificateur diabolique qui se repent… Le Diable opère souvent au cinéma tel un moteur de narration ; il permet à l’homme de dépasser sa condition. Traditionnellement, en combattant le Mal, le personnage principal se transforme et donne sens à son existence ; l’ayant vaincu, il devient un héros. Comme l’écrit Nietzsche, « il faut avoir des adversaires vigoureux pour devenir fort soi-même ». L’adversaire s’incarne généralement sous les traits d’un méchant. Les figures maléfiques les plus emblématiques du cinéma demeurent : le serial killer, le psychopathe, le tueur sanguinaire ou le méchant absolu. Parmi les plus célèbres, on citera : Hannibal Lecter du Silence des agneaux de Demme en 1991, Arthur Fleck dans Joker de Phillips en 2019, Alex dans Orange Mécanique de Kubrick en 1971, John Doe dans Seven de Fincher en 1995, Hans Landa d’Inglorious Basterds de Tarantino en 2009 ou encore Dark Vador dans la franchise Star Wars…
Le Diable dans la pub et l’industrie du divertissement : un allié ou un modèle déculpabilisant
Ces dernières années, on assiste de nouveau à un changement de regard sur le Mal. Si l’homme reconnaît sa part du Diable, il semble qu’il ne cherche plus à la combattre. Des films grand public interrogent la complexité du Mal sous un angle bienveillant (ex : la Reine réinventée de Blanche Neige dans Maléfique de Stromberg en 2014). Le Mal n’est plus monstrueux ; il est banal. Son image devient floue, ses contours indistincts. Ce que des artistes contemporains comme Serrano, Dibbets ou Fabre soulignent dans leurs œuvres. L’industrie du divertissement en profite pour démystifier le Diable. Depuis longtemps déjà, afin de nous pousser à consommer sans culpabiliser, la publicité le présente non pas comme l’ennemi de l’homme mais comme son allié. Elle transforme l’image du dangereux Prince des tentateurs pour le rendre inoffensif et corvéable à merci. S’abandonner à nos vices nous parait ainsi un moindre mal pour un bien. De récentes séries à succès comme Lucifer et The chilling adventures of Sabrina ou bien encore le documentaire Hail satanou œuvrent à présent à rendre le Diable ‘’cool’’ ; voire même à le considérer comme un partenaire idéal (ex : la pub fin 2020 pour le site de rencontres Match avec Deadpool). Sous l’influence grandissante des réseaux sociaux et des jeux vidéo, son style de vie ne semble plus vraiment immoral. La merchandisation de l’homme afin d’acquérir richesse, succès et pouvoir, l’hypersexualisation et la violence s’envisagent tels des comportements sans conséquences.
Le satanisme, associé il y a peu encore à un genre musical marginal et contestataire (Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Venom, Marilyn Manson…) et un univers visuel vile et sanguinaire, se démocratise. Ses meilleurs influenceurs – des superstars de la musique pop – glorifient ouvertement ses valeurs. Ils adoucissent son image par le kitsch et le chic afin de les rendre acceptables pour tous. On citera à titre d’exemples : la rappeuse Nicky Minaj qui réalise une messe noire à la cérémonie des grammys awards en 2012 ; Lady Gaga, Tailor Swift ou encore Justin Bieber qui s’affichent avec ses attributs; Katy Perry qui dans son clip Bon appétit (comme dans les performances Spirit cooking d’Abramovic) invite à pratiquer le cannibalisme. Ainsi, souvent en ayant recours au second degré de même qu’à une esthétique séduisante et sophistiquée, l’industrie du divertissement et la publicité modifient inconsciemment notre perception de Satan.
Lucifer, Ahriman et Dionysos : des forces pour un éveil ou un plus doux sommeil
Mais la crise du Covid-19 place de nouveau l’homme face à la mort; la maladie autant que les interdits imposés par la société bouleversent le rapport à la vie. Le Diable met à profit ce moment singulier pour se jouer une nouvelle fois de nous. De grands penseurs du 20ème siècle nous éclairent sur l’Adversaire qui tente aujourd’hui de saisir chacun par le corps, l’âme ou l’esprit. Dans Lucifer et Ahriman, Steiner évoque deux forces du Mal opposées œuvrant en ce Monde et l’organisme humain. L’auteur décrit la première, Lucifer, comme « la puissance qui excite dans l’homme toutes les exaltations, tous les faux mysticismes, l’orgueil qui pousse l’homme à l’élever au-dessus de lui-même ». Lucifer trouble l’âme de ceux qui aspirent à la vérité, à la beauté et à la liberté. Il leur fait miroiter sa fausse lumière ; l’expérience de la véritable n’étant possible qu’en se tournant vers Dieu. La seconde, « Ahriman est la puissance qui rend l’homme aride (…) et qui l’entraîne aux superstitions matérialistes ». Comme dans la trilogie Matrix des sœurs Wachowski, il dupe son esprit rationaliste, se jouant de son besoin de sécurité et de conservatisme. Ahriman tente de lui faire croire que ce monde est paradisiaque afin de l’y maintenir endormi.
Nietzche pour sa part utilise un autre référentiel : celui de la tragédie grecque. Dans Naissance de la Tragédie, il nous parle de la pulsion apollinienne (qui maintient ceux qui rêvent dans l’illusion d’un idéal de beauté, de sérénité, de lumière…) et de la pulsion socratique (qui maintient ceux qui raisonnent dans le mensonge d’un optimisme rationaliste). Mais le philosophe contemporain identifie également une plus ancienne puissance qui opère par le corps : la pulsion dionysiaque. Dionysos personnifie selon l’auteur la force vitale qui incite l’homme à transgresser ses limitations. Elle libère ses instincts et le pousse à tous les excès comme les scènes orgiaques de bacchanales en témoignent souvent dans l’art. Dionysos révèle ainsi à l’homme sa condition : sa nature bestiale comme son funeste destin. Pour l’adoucir, il l’invite à jouir du présent ; ce qu’illustrent des films sortis en 2021 tels Guermantes d’Honoré ou Les Olympiades d’Audiard. Mais chez les grecs, cette puissance possède un autre pouvoir : elle renouvelle toute forme de vie. C’est pourquoi l’expérience dionysiaque permet aussi à l’homme qui accepte sa condition de la transcender. Ainsi, Steiner et Nietzche portent un autre regard sur la figure du Mal. Ils nous invitent à percevoir comment des forces opèrent afin de maintenir les hommes dans l’illusion et le chaos sur terre. Mais ces auteurs nous enseignent également que celui qui en prend conscience et s’éveille peut agir tout autrement.
Si la nature comme l’origine du Diable demeurent insaisissables, la figure du Mal absolu se présente souvent dans l’art pour permettre à l’homme de se connaître et se réaliser. L’Adversaire semble inlassablement le placer face à un choix existentiel : le dépassement pour atteindre un idéal ou l’abandon aux plaisirs éphémères d’un paradis artificiel ; l’éveil et l’élévation vers la Lumière ou l’enténèbrement dans la matrice ou la caverne de Platon… En Occident, ni la religion ni la société ne peuvent aujourd’hui lui imposer sa voie. C’est, en conscience, qu’il lui appartient de faire ce choix.